Le Verbe de Dieu et le témoignage de son Église
Après avoir montré comment on pouvait aborder de façon peu pertinente le problème (bien sérieux, lui) de la vie de Jésus de Nazareth, envisagée d’un point de vue historique, il paraît logique d’essayer de proposer des pistes plus constructives. Ce travail en tant que tel a déjà été réalisé de belle façon : c’est surtout sur ses enjeux que nous nous arrêterons, car ils sont absolument essentiels. Parler de Jésus n’a rien d’anodin ou de simple, mais implique au contraire une expérience particulière et d’une grande profondeur, qui engage l’Église tout entière et la vie de chaque croyant. À défaut d’en tenir compte, on court le risque de manquer l’essentiel, voire de le tordre, volontairement ou non.
Le livre de Reza Aslan pose, on l’a vu, un grand nombre de problèmes sérieux, dont une difficulté à entrer dans une compréhension minimale des Écritures et donc, à plus forte raison, à comprendre ce que signifie leur accomplissement en Jésus Christ. À vrai dire, la meilleure réponse à ce livre a déjà été apportée, par anticipation, entre 2007 et 2012, par un auteur pas tout à fait inconnu : Joseph Ratzinger alias Benoît XVI, dont le livre en trois volumes, Jésus de Nazareth, vise précisément à appréhender les apports de la recherche historico-critique sur la vie de Jésus tout en inscrivant la démarche dans une perspective croyante, qui en illustre autant les apports que les limites. L’écart abyssal entre cette œuvre dense et profonde et les hypothèses terriblement réductrices de Reza Aslan est spectaculaire.
Plutôt que de nous arrêter à cette référence ou de résumer pauvrement le livre de Joseph Ratzinger, il ne paraît pas inutile de proposer quelques pistes de réflexion sur le problème de la valeur et de la signification des Écritures, en particulier des Évangiles, et sur les critères qui permettent à l’Église d’interpréter les Écritures comme elle le fait. Cette démarche d’interprétation, avec ses présupposés, ses règles et ses enjeux – ce qu’on appelle une herméneutique – ne peut qu’apparaître bien plus riche et lumineuse que la lecture desséchée et appauvrie qu’un certain historicisme peut susciter.
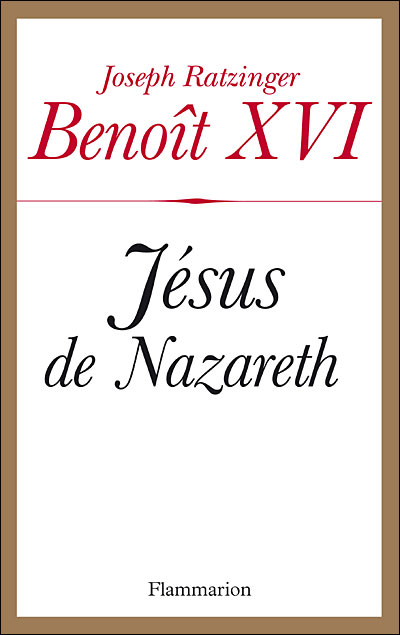
En effet, contrairement à ce que croient ou tentent d’imposer certains historiens, la recherche d’une vraie objectivité scientifique sur la vie de Jésus de Nazareth n’est pas un plus, elle est un moins.
C’est le problème qu’illustre, à sa façon, le film récent sur La Résurrection du Christ (Risen, de l’autre côté de l’Atlantique). Le tribun Claudius est secoué profondément parce qu’il a vu le Christ mort sur la Croix, puis l’a retrouvé bien vivant au milieu des disciples, au Cénacle, identique. Cet enquêteur antique est bouleversé par l’événement impossible du retour à la vie d’un homme ; à notre époque, en mode les Experts-Jérusalem, il aurait aussitôt recouru à un prélèvement ADN ou relevé les empreintes digitales du suspect pour tirer l’affaire au clair. L’épisode résonne étrangement avec les récits d’apparition du Christ à ses disciples, qui ont toujours le plus grand mal à le reconnaître, bien qu’ils l’aient auparavant fréquenté longuement – et bien vivant, contrairement à Claudius. Et pourtant ils le reconnaissent, au bout du compte, d’une façon toute particulière, le cœur brûlant, à ses gestes, à ses paroles, à ses blessures – et non à ses traits. Claudius, l’étranger, est le seul qui s’en tienne à l’identité des traits du crucifié et de l’homme qui se présente à lui, seule garantie possible pour lui qui n’a ni marché ni mangé avec le Christ avant sa mort. En un sens, il ne le reconnaît pas tant personnellement qu’il ne l’identifie rationnellement, au prix d’un sérieux mal de crâne devant cet impossible retour à la vie.
Il est en cela une figure de l’homme moderne, largement ignorant de l’identité de Jésus, et qui ne peut ou ne veut se raccrocher qu’à des éléments objectifs, matériels, extérieurs. Cela ne peut provoquer qu’un insupportable paradoxe, conduisant ou bien au rejet positiviste de toute idée de résurrection (le miracle doit avoir une autre explication, ou relever du fantasme) ou bien comme Claudius à une forme de curiosité devant ce qui révèle une puissance divine inédite et plus tangible que celle du dieu Mars. À notre époque, et sans le témoignage direct des sens reçu par Claudius, le choix est vite fait. Notre tribun, lui, est frappé par ce miracle et suit les disciples pour essayer de comprendre cet événement. Il n’est peut-être pas différent, après tout, de Moïse, qui se détourne de son troupeau pour contempler le mystère d’un buisson brûlant sans se consumer. Mais là où Dieu parle à Moïse du cœur du buisson, Claudius n’est guidé que par le phénomène miraculeux. Il faut attendre un échange avec le Ressuscité, la nuit, au bord de la mer, pour qu’un lien personnel se crée et qu’il se découvre déjà connu et aimé par Jésus, seul gage d’un futur témoignage sur celui qu’il a rencontré.
Le problème est bien plus sérieux pour les apôtres, incapables dans le film de comprendre ni de témoigner de quoi que ce soit. Leur amour sincère et débordant pour le Christ est nettement représenté, mais ils restent parfaitement creux, une bande de bons gars sympathiques, pas loin d’être hippies, mais sans rien de plus. Pierre, pourtant censé être capable d’un grand témoignage et d’un discours scripturaire construit en plein Jérusalem, cinquante jours après Pâques (Ac 2,14-40), n’a rien à dire à Claudius sur Jésus. C’est que l’affectif seul ne peut suffire. De façon significative, Barthélémy, pour expliquer à Claudius pourquoi les disciples ont suivi le Christ, montre le lépreux que le Christ vient de guérir, indiquant que ce sont les miracles qui les ont attirés ou gardés près de Jésus. On est loin du témoignage de Jean (« Voici l’agneau de Dieu », Jn 1,36) ou de l’appel des apôtres dans les Évangiles (« Suis-moi »), et plus loin encore de la réponse de Pierre à Jésus au terme du discours du Pain de Vie à Capharnaüm, qui vient de faire scandale : « Maître, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6,68).
C’est cette parole qui manque dans le film, cette parole qui a nourri les apôtres et construit leur témoignage. Quand bien même la Résurrection reste un événement incompréhensible pour eux, Jésus leur en a donné les clés, comme il l’a fait une nouvelle fois, a posteriori, sur la route d’Emmaüs. Cela seul permet de dépasser un élan affectif vague et incommunicable : l’effusion de l’Esprit n’est pas un nouveau miracle (ou une curieuse et soudaine explosion dans le soleil levant, comme dans le film) qui projetterait des paroles automatiquement par la bouche d’apôtres possédés. C’est cette parole et la connaissance intime de Jésus qui s’associent pour livrer un témoignage authentique et profond. Ce n’est pas un hasard que Jean soit à la fois considéré comme le plus théologique et le plus précis des Évangélistes dans son témoignage sur la vie de Jésus, dans les dates, les lieux, les différents épisodes : l’objectivité visée par les historiens n’est pas à l’opposé de la lecture spirituelle, elles se nourrissent mutuellement. Et si son Évangile est le plus tardif, c’est peut-être aussi que ce témoignage si profond et élevé passe par une longue méditation et un approfondissement progressif : tout n’est pas donné une fois qu’un fait a été constaté, surtout si ce fait central est la Résurrection.

Au lieu de quoi, nombre d’historiens du christianisme, n’arrivant pas à saisir qui était Jésus, prétendent que ce qui a fait le christianisme lui est postérieur, est une transformation, voire une véritable création qui s’écarte de façon plus ou moins radicale de l’enseignement du rabbi galiléen. Il y aurait eu, à un stade quelconque, un habile idéologue (Paul, de l’avis général), ou bien même plus tard encore un stratège politique efficace comme Constantin, pour façonner cette nouvelle religion, dont il faut reconnaître qu’elle est alors étonnamment durable pour quelque chose d’aussi hâtivement bricolé et à ce point détaché de celui que l’on continue pourtant de reconnaître comme son fondateur.
Loin de cet historicisme qui réduit le christianisme à une idéologie étroite, on peut se nourrir de l’approche de Bergson, beaucoup plus juste quoique (ou parce que) moins ambitieuse. Dans Les deux sources de la morale et de la religion, il affirme en effet :
Du point de vue où nous nous plaçons, et d’où apparaît la divinité de tous les hommes, il importe peu que le Christ s’appelle ou ne s’appelle pas un homme. Il n’importe même pas qu’il s’appelle le Christ. Ceux qui sont allés jusqu’à nier l’existence de Jésus n’empêcheront pas le Sermon sur la montagne de figurer dans l’Évangile, avec d’autres divines paroles. À l’auteur on donnera le nom qu’on voudra, on ne fera pas qu’il n’y ait pas eu d’auteur. Nous n’avons donc pas à nous poser ici de tels problèmes. Disons simplement que, si les grands mystiques sont bien tels que nous les avons décrits, ils se trouvent être des imitateurs et des continuateurs originaux, mais incomplets, de ce que fut complètement le Christ des Évangiles.
Autrement dit, le christianisme repose sur une personne dont l’expérience est spirituellement indépassable. On conçoit mal dès lors comment ce véritable fondateur aurait choisi (et comment ses disciples auraient accepté) de se référer comme modèle à un dénommé Jésus dont l’enseignement serait pourtant nettement inférieur au sien. C’est tout l’enjeu de l’affirmation de Jésus à Nicodème, selon laquelle « nul n’est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’Homme » (Jn 3,13) : pour ouvrir le chemin du ciel, l’auteur du Sermon sur la Montagne doit en être d’abord descendu. Si l’historien échoue à se prononcer sur la divinité de Jésus, tout contribue pourtant à faire de celui-ci le véritable fondateur du mouvement chrétien.

Même Paul, que Reza Aslan prétend totalement éloigné voire ignorant de la personne de Jésus, insiste sur sa fidélité à un enseignement qu’il a reçu et qu’il s’efforce de transmettre sans rien en modifier, sans revendiquer d’autorité proprement nouvelle, par exemple pour la Cène, dont il ouvre l’évocation par ces mots : « Pour moi, en effet, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis » (1 Co 11, 23). Et de façon saisissante, les paroles qu’il cite, reçues du témoignage des apôtres, sont restées sensiblement les mêmes jusqu’à aujourd’hui.
Et l’on pourrait encore citer, un peu plus loin :
Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j’avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu’il a été mis au tombeau, qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu’il est apparu à Céphas, puis aux Douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart d’entre eux demeurent jusqu’à présent et quelques-uns se sont endormis – ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et, en tout dernier lieu, il m’est apparu à moi aussi, comme à l’avorton. Car je suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu. (1 Co 15, 1-9)
Vouloir distinguer à toute force la personne de Jésus de la religion chrétienne, c’est donc s’interdire d’emblée de comprendre quoi que ce soit au témoignage que celle-ci porte sur celui-là. L’objectivité revendiquée par ce type d’approche conduit en fait à un jugement largement irrationnel et totalement péremptoire qui ampute l’expérience chrétienne de l’essentiel de ce qui la constitue : il apparaît déjà que la transmission (ou, pour employer un terme consacré, la tradition) d’une expérience décisive rapportée à Jésus en est le cœur.
Pour sortir des contradictions soulevées par une démarche comme celle de Reza Aslan, il faut savoir tenir compte de la nature réelle du témoignage que les Évangiles – et plus largement les Écritures – apportent. Il ne s’agit pas de perdre en objectivité mais de gagner en profondeur et en cohérence pour intégrer l’expérience chrétienne telle qu’elle se vit plutôt que de prétendre l’expliquer en la réduisant à quelques pauvres idées philosophico-religieuses de la période hellénistique. Il faut savoir proposer une lecture ajustée, c’est-à-dire une méthode d’interprétation pertinente – ce qu’on appelle donc, en termes techniques, une herméneutique pertinente.
À la différence de ce qu’on appelle l’exégèse, c’est-à-dire l’analyse technique d’un texte (historique ou littéraire), aussi neutre et descriptive que possible, idéalement sans aucune dépendance à l’égard de son auteur, l’herméneutique est une lecture engagée, qui interprète. Elle se nourrit toutefois de l’exégèse au même titre que l’Incarnation passe par une personne toute humaine pour révéler le Père, au même titre que la raison et la foi ne sont pas des ordres autonomes voire contradictoires, mais « les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la connaissance de la vérité » (Fides et ratio, 1). Encore faut-il ne pas y voir une dialectique ou la mystérieuse correspondance de deux ordres étrangers l’un à l’autre mais répondant à une « harmonie préétablie ». C’est que, comme y insiste Joseph Ratzinger, « la foi chrétienne, en vertu de sa structure fondamentale, n’est pas pure confiance sans contenu, mais toujours confiance en quelqu’un de tout à fait déterminé et en sa parole, donc toujours rencontre avec une vérité dont le contenu doit être exprimé » [1]. Autrement dit, la foi a un contenu et ce contenu est rationnel, mais aussi source de rationalité : affirmer que Jésus a vécu et est ressuscité en un temps donné, que le même Dieu qui s’est incarné est aussi le Créateur de l’univers, c’est justement le point de départ de la disparition de toute mythologie irrationnelle. Ce n’est pas un hasard si le polythéisme antique a disparu en quelques siècles sans laisser la moindre trace. Opposer de façon dialectique foi et raison est donc mortel, comme toute dialectique qui entendrait extérioriser et séparer au lieu d’unir. La théologie n’est donc pas une suite d’élucubrations irrationnelles, elle est « une rationalité se maintenant au sein de la foi et développant les structures propres de la foi » [2] : on peut même affirmer que la seule véritable théologie, au sens le plus étymologique (« discours sur Dieu »), est l’Écriture, « car elle a vraiment Dieu pour sujet, elle ne se contente pas de parler de Dieu mais elle est son parler, elle le laisse parler lui-même » [3].
Le témoignage d’un croyant n’est donc pas par principe irrationnel. Il déploie une rencontre vécue, une histoire personnelle nourrie de la connaissance du Christ et de la lecture des Écritures. C’est cette profondeur que l’approche censée être objective laisse de côté en prétendant s’abstraire de ce qui ne serait pas vérifiable ou rationnel, dans un sens terriblement restrictif, en se limitant à des textes dont on prétend arracher avec diverses tenailles la vérité qui y aurait été dissimulée. L’expérience chrétienne, elle, ne provient pas des textes. Plus précisément, la vie spirituelle s’appuie sur trois pôles qui s’éclairent mutuellement : la personne de Jésus, les Écritures (qu’il accomplit ou bien qui témoignent de sa venue et de l’œuvre de l’Église) et la propre vie du croyant. Parler de Jésus de la façon la plus intégrale et authentique possible, c’est nécessairement témoigner de la façon dont a lieu, dans sa vie, une rencontre avec lui éclairée par les Écritures, d’une façon qui produit du sens. S’il est vrai que l’analyse sérieuse d’un texte littéraire, dans sa dimension historique, linguistique, stylistique, humaine, n’est pas pur verbiage, alors combien plus l’expérience chrétienne, forte de ses différentes composantes, est-elle riche !

Or, ce qui vaut pour le croyant de façon individuelle vaut également à l’échelle de l’Église. Le fondement de son témoignage, de sa prédication, de son œuvre, n’est pas dans les Écritures, comme l’a rappelé le Concile dans Dei Verbum, qu’il faut absolument (re)lire :
C’est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s’achève toute la Révélation du Dieu très haut (cf. 1 Co 1, 30 ; 3, 16-4, 6), ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l’Évangile d’abord promis par les prophètes, ordonna à ses Apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les Apôtres, qui, par la prédication orale, par leurs exemples et des institutions, transmirent, ce qu’ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou ce qu’ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, soit par ces Apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l’inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut.
D’emblée se dessine la spécificité du témoignage de l’Église : elle est le prolongement de l’Évangile de Jésus lui-même, par une prédication en paroles et en actes et par des institutions, et en même temps par la consignation par écrit de ce qui est devenu le Nouveau Testament, témoignage de l’accomplissement des Écritures fixées dans l’Ancien Testament.
La Tradition, notion généralement mal comprise et facilement instrumentalisée, n’est donc pas la transmission matérielle des Écritures, ni même l’ensemble plus ou moins poussiéreux et plus ou moins intelligible des textes produits par l’Église, notamment par les Pères des premiers siècles. Cette vision intellectualisante est à la limite du contresens. L’Évangile est transmis par la prédication des successeurs des Apôtres, les évêques et par les Écritures, mais aussi, indissociablement, par la Tradition.
[Celle-ci] comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi ; ainsi l’Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte et elle transmet à chaque génération, tout ce qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit. Cette Tradition qui vient des Apôtres progresse dans l’Église, sous l’assistance du Saint-Esprit ; en effet, la perception des réalités aussi bien que des paroles transmises s’accroît, soit par la contemplation et l’étude des croyants qui les méditent en leur cœur (cf. Lc 2, 19.51), soit par l’intelligence intérieure qu’ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Ainsi l’Église, tandis que les siècles s’écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu’à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu.
L’accord entre les Écritures et la Tradition relève du discernement du Magistère : celui-ci « n’est pas au-dessus de la Parole de Dieu, mais il est à son service, n’enseignant que ce qui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l’assistance de l’Esprit Saint, il écoute cette Parole avec amour, la garde saintement et l’expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu’il propose à croire comme étant révélé par Dieu ».

On retrouve les intuitions développées au tournant du XXe siècle par Maurice Blondel, qui a entrepris, dans une série de trois articles intitulée Histoire et dogme [4], de sortir de la dialectique stérile qui menaçait l’Église, prise entre le relativisme de la science historique naissante et le fixisme dogmatique qui lui a répondu sur le mode de la crispation. Blondel a montré comment, loin de devoir choisir entre l’un de ces camps, il fallait revenir au sens fondamental de la Tradition comme vie de l’Église, déployant la Révélation de Jésus dans la vie, les actes et les paroles de tous ceux qui le suivent, jusqu’au plus humble : elle est en effet « un autre moyen de connaître son auteur, de participer à sa vie ». De ce fait, « toute définition doctrinale est beaucoup moins une innovation qu’une reconnaissance authentique d’anticipations et de vérifications collectives ». Dans cette perspective, il faut alors voir dans l’action du Christ moins une vérité pour la conscience qu’une réalité agissante. Enfin, le surnaturel introduit en la personne du Christ n’est ni un rapport de notions déterminé et imposé de l’extérieur par Dieu, qui resterait fondamentalement extrinsèque au naturel (c’est le drame du tribun Claudius, incapable de comprendre le phénomène incroyable qu’il constate) ni un autre nom pour désigner la concentration du divin dans la nature (porte ouverte à une religiosité intellectuelle et élitiste, mais sans transcendance) : c’est une relation d’amour, présente au cœur de l’homme mais qui l’ouvre à toujours plus que lui-même. En définitive, explique Blondel, le mystère à contempler est celui de la conscience du Christ, qui est le véritable centre unificateur et agissant : « loin donc qu’il faille amortir la divinité ou diminuer l’humanité du Christ pour les garder sauves l’une de l’autre, peut-être est-ce en prenant plus profondément conscience de leur réalité et de leur intimité que nous découvrirons le secret de leur unité en Lui et de leur union surnaturelle en nous ».
En somme, ce qui atteste de l’identité de Jésus comme Christ, comme Fils de Dieu, ce n’est pas le retour le plus myope possible à des bribes de vérité scientifique potentiellement égarés dans le douteux tissu des textes chrétiens, et qui ne livreront jamais rien de conclusif : c’est le témoignage déployé d’une façon toujours nouvelle, toujours approfondie, toujours imprévisible, par l’Église. Cela n’exclut certes pas la possibilité de contre-témoignages au cours d’une histoire déjà bien longue. Seulement l’Église, « toujours à réformer » en tant qu’institution, continue à attester, par la vie de foi des fidèles, du Pape au plus humble d’entre eux, dans la vie quotidienne comme dans la liturgie, de la vitalité de l’Évangile qu’elle annonce. Une telle œuvre, une telle croissance, un tel déploiement, ne peut relever d’un bricolage conceptuel appuyé sur une religiosité datée, quelques décennies après le passage de Galilée en Judée d’un agitateur politique.
Il est à la fois nécessaire et particulièrement difficile d’en passer par l’Église pour accéder au Christ, et c’est bien tout le problème qui se pose à nos contemporains. Comme l’écrivait en 1938 Henri de Lubac, dans Catholicisme, « le mystère de l’Église, plus profond encore s’il est possible, est plus “difficile à croire” que le Mystère du Christ, comme celui-ci déjà était plus difficile à croire que le Mystère de Dieu ». Que Dieu s’incarne, meure sur la Croix et ressuscite a toujours constitué à la fois « un scandale pour les juifs et une folie pour les païens », comme le soulignait déjà Paul (même si le scandale vaut aussi désormais largement pour les païens de notre temps). Mais c’est un scandale plus grand encore, et particulièrement pour notre modernité, que l’Église puisse en être la dépositaire fidèle. Et pourtant nulle part ailleurs qu’en elle ne se révèlent le Chemin, la Vérité et la Vie qu’est pour nous Jésus de Nazareth.
[1] Joseph Ratzinger, « Église et théologie scientifique », in Théologie et anthropologie de la foi, Téqui, 2012, p. 34.
[2] Ibid., p. 37.
[3] J. Ratzinger, « Question de structure de la théologie », op. cit., p. 24.
[4] Histoire et dogme a été publié originellement dans La Quinzaine, sous la forme de trois articles successifs (datés du 16 janvier, du 1er février et du 16 février 1904).

