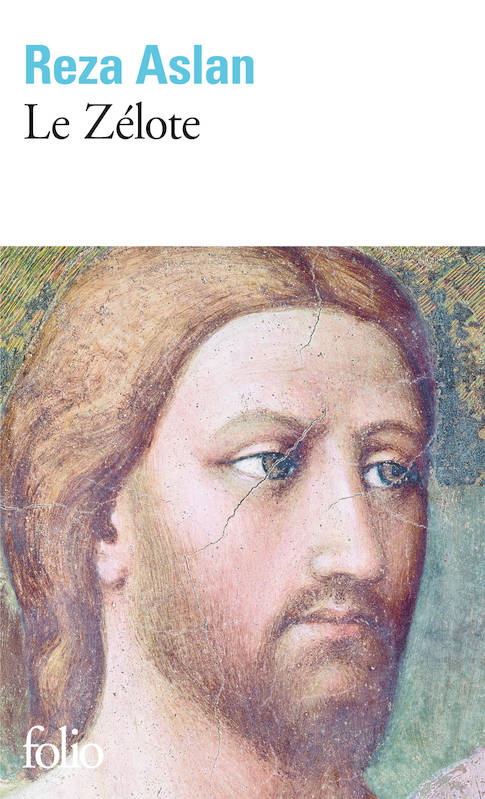La « biographie » d’un « révolutionnaire »
Dans ce premier article, nous abordons spécifiquement le livre Le Zélote et son approche très séduisante mais très problématique. Nous verrons, sur un certain nombre de points essentiels (sans reprendre la riche matière de l’ensemble du livre, ni reprendre tous les points de détail), comment Reza Aslan adopte une approche biaisée et largement contestable, notamment dans son traitement des Évangiles, qu’il discrédite largement : il y voit des récits tardifs complètement réélaborés par les disciples, et pourtant il s’en inspire largement en essayant de rétablir leur « vrai » sens. Ce faisant, il prétend retrouver ce qui serait la biographie d’un révolutionnaire typique du 1er siècle en Judée, passant ainsi doublement à côté de son sujet.
Depuis bientôt deux siècles, les tentatives d’écrire une biographie « objective » de Jésus sont nombreuses, comme Reza Aslan le reconnaît avec lucidité, ajoutant même apparemment sans ironie envers lui-même, que « trop souvent, ce sont eux-mêmes qu[e] les spécialistes voient – leur propre reflet – dans le portrait de Jésus qu’ils ont construit ». De fait, les grandes lignes de son entreprise n’apportent rien de neuf et sont même par moments assez datées.
Ainsi, pour faire vaciller d’emblée les certitudes, l’auteur rappelle combien les textes fondateurs sont discutables, écrits sans doute par d’autres que ceux dont ils portent le nom et de façon très tardive. Il rappelle la théorie selon laquelle les Évangiles se seraient constitués à partir d’une première collection de paroles du Christ, intitulée source Q (pour Quelle, la source en allemand), qui aurait donné l’Évangile de Marc, le plus court, puis Matthieu, Luc et enfin, très tard, Jean. En réalité, les chercheurs doutent de plus en plus de la réalité de cette hypothétique source Q et certains en viennent même à se demander si l’Évangile de Marc, plutôt qu’une première version un peu sommaire de la vie de Jésus, ne serait pas en fait une version délibérément plus condensée des deux autres synoptiques, Matthieu et Luc, avec une perspective théologique propre. De plus, Reza Aslan retient délibérément les dates les plus tardives possibles pour la composition de chaque Évangile, ce qui permet d’en souligner, selon lui, la fragilité.
Le problème de son approche, après tant d’autres, c’est qu’elle s’appuie sur une logique quasi exclusivement textuelle : il faudrait une première source écrite, puis d’autres développements écrits, pour obtenir le texte des Évangiles – et pourtant, même ainsi, il ne distingue pas d’éventuels stades d’écriture, comme si les Évangiles étaient sortis d’un coup de la tête d’un unique auteur, sans avoir été repris, précisés, complétés par la suite, en tant que textes élaborés et reçus dans une communauté. De façon fondamentale, Reza Aslan ignore le développement récent d’une approche anthropologique de la transmission orale des textes, appliquée aux Évangiles, qui apparaissent dès lors pour l’essentiel comme l’enseignement d’un maître à ses disciples, mis en forme pour être mémorisé et transmis par ces derniers. Cette dimension nous est aujourd’hui devenue largement étrangère. Pourtant, les travaux du P. Guigain montrent de façon spectaculaire ce qu’une lecture attentive aux marques de composition et de mémorisation apporte à la compréhension des Évangiles, qui ont pu être transmis pendant des années voire des décennies sans changement notable, avant une mise par écrit qui les fait basculer dans un registre différent [1].
Reza Aslan rejette donc un peu vite la validité du témoignage des Évangiles, au profit d’une thèse très simple, mais déjà forcée :
il n’existe que deux faits historiques concrets sur Jésus de Nazareth et sur lesquels nous pouvons nous appuyer en toute confiance. Le premier était que Jésus était un juif qui dirigea un mouvement populaire juif en Palestine au début du Ier siècle de notre ère : le second, que Rome le crucifia pour cette raison. [Avec l’aide de l’histoire], ces deux faits peuvent nous aider à tracer un portrait de Jésus peut-être plus exact sur le plan de l’histoire que celui des Évangiles. Le Jésus qui se dessine au fil de cet examen historique – un révolutionnaire convaincu, emporté comme tous les Juifs de son temps dans le vortex politique et religieux de la Palestine de ce siècle – ressemble peu à l’image du doux pasteur cultivée par la communauté chrétienne primitive (p. 32).
La prétention de l’affirmation et l’aspect caricatural de l’opposition entre révolutionnaire et doux pasteur est patente. Reste à en mesurer les conséquences. Pour Reza Aslan, ces faits sont les seuls sûrs car les Évangiles auraient pris forme pour l’essentiel après la révolte juive désastreuse de 66-70, qui conduit à la destruction du Temple et au massacre de la plupart des Juifs de Judée, ainsi qu’à la reconfiguration générale du judaïsme vers le judaïsme rabbinique, seul survivant de la débâcle. L’altération du témoignage sur Jésus serait donc devenu nécessaire en un temps où plus aucune révolte ne semblait pouvoir se faire jour contre Rome (même si l’auteur évoque par ailleurs la dernière grande révolte de Bar Kochba en 135). Selon lui, « c’est ainsi que s’amorça la longue transformation de Jésus, nationaliste juif révolutionnaire, en un chef spirituel pacifique se désintéressant des affaires de ce monde » (p. 35), les dites affaires ne semblant pouvoir être que la prise des armes pour changer un ordre politique, ce qui est une vision pour le moins étriquée.
Par conséquent, en dehors de tout ce qui appuie directement sa thèse, ou qu’il peut y intégrer – comme le « raid » (sic) de Jésus sur le Temple avec ses disciples, raconté avec autant de force que de déformations, seul événement qui corroborerait le caractère vraiment révolutionnaire de Jésus et où apparaît opportunément le terme de « zèle » (Jn 3), vite plaqué sur le mouvement zélote –, le reste n’a pas de solidité et ne sert selon notre auteur qu’à rendre acceptable l’enseignement de Jésus pour les Romains. Peu importe que, ce faisant, le chef de guerre devienne non pas seulement un peu plus consensuel, mais exactement le contraire de ce qu’il était censé être à l’origine. En fait, Reza Aslan confond largement le problème de l’historicité ponctuelle de certains passages (notamment les Évangiles de l’enfance, objets de vrais débats, ou encore la vie et les enseignements de Jean-Baptiste, qui demeurent obscurs pour les historiens, ou les détails de la Passion) et le problème de la valeur globale de témoignage des Évangiles, censés ne parler que du Christ des chrétiens, et empêcher de connaître l’homme Jésus – alors même que de nombreux historiens ont travaillé sur ces aspects sans cesser d’être chrétiens pour autant (c’est le cas du premier auteur qu’il cite en annexe, John Meier, auteur d’une monumentale biographie en quatre tomes sur Jésus, un juif marginal).
Paradoxalement, comme tant d’autres avant lui, il ne s’interdit pas pour autant de plonger dans les Évangiles, pourtant selon lui faussés jusqu’à interdire de connaître quoi que ce soit au Jésus de l’histoire. Ils semblent représenter un témoignage contourné et paradoxal dont il aurait seul la clé pour le déconstruire. Rien de neuf ici, ce phénomène a déjà été illustré, en France, par les documentaires largement contestables, sinon pernicieux, et surtout les livres navrants de Jérôme Prieur et Gérard Mordillat [2]. Ils s’attachent à montrer dans le détail que les Évangiles sont de grossières manipulations idéologiques : ils n’en retiennent dès lors que les passages qu’ils peuvent interpréter à l’appui de leurs théories, aveugles aux contradictions qu’ils introduisent eux-mêmes. Ainsi, cela ne leur pose pas problème d’affirmer que la primauté de Pierre serait une invention tardive ajoutée aux Évangiles, par souci de centralisation du pouvoir, et que les Évangélistes auraient dans le même temps oublié d’enlever les versets qui suivent, où Jésus appelle Pierre « Satan » parce qu’il refuse l’idée que le Messie puisse être tué, ce qui fait pourtant mauvais genre pour un futur chef de communauté.
De la même façon, Reza Aslan reprend à grands traits les Évangiles, cherchant à faire émerger derrière les événements son Jésus chef de faction. S’il s’est véritablement bien documenté et déploie des panoramas historiques de façon convaincante dans les premiers chapitres, il tire toutefois profit de la moindre incertitude historique pour imposer un doute radical puis substituer aux récits évangéliques sa propre vision, sans plus d’argumentation. Par exemple, il affirme que Jésus, simple disciple de Jean, partit après son baptême dans le désert (c’est-à-dire « directement à l’endroit d’où Jean avait surgi un peu avant », comme si le désert était un lieu-dit circonscrit), et cela « pour s’instruire auprès de Jean et vivre en commun avec ses disciples » (p. 163). Cette thèse fantaisiste ne vaut que si l’on considère que les Évangiles n’ont pas su effacer le passage de Jésus au désert, tout en voulant en cacher le véritable sens. Absolument rien ne vient l’étayer, si ce n’est la volonté de faire dépendre le plus possible Jésus de la communauté de Jean.

Toutes les analyses sur le Royaume, son imminence, sa nature, sont de même incroyablement contournées : Jésus voudrait établir le royaume de Dieu, qui est en fait un régime strictement temporel, ce qui rend son absence de réalisation d’autant plus problématique. Les paraboles et les discours sur le Royaume sont vite évacués. Rien ne vient vraiment étayer que Jésus ait cherché à mettre en place une armée : au contraire, les Évangiles montrent comment il a progressivement éloigné ses propres disciples par la radicalité de son enseignement. Sans doute l’auteur y verrait-il une façon de justifier son échec – même si tout cela ne fait que rendre toujours plus incompréhensible que ce révolutionnaire-ci, celui dont l’action a laissé le moins de traces parmi tous ceux qui ont pris les armes à cette époque, ait été choisi pour assumer post mortem une figure aussi imposante : roi, Messie, Fils de Dieu, Verbe fait chair…
Le discours de Jésus est censé apporter une libération aux opprimés en renversant les riches, selon une logique de lutte des classes qui a de fait eu largement cours au XXe s. Difficile pourtant d’en trouver des attestations – sauf à décréter qu’elles ont été gommées. Mais que dire de l’affirmation selon laquelle « il est plus difficile pour un riche d’entrer dans le royaume de Dieu qu’à un chameau de passer par le trou de l’aiguille ? » Les disciples n’auraient-ils pas dû se réjouir de la défaite annoncée de leurs ennemis, du « 1 % » ? Et pourtant, leur réponse n’a rien à voir avec les 99 % et impose une compréhension bien plus radicale : « mais qui peut être sauvé ? ».
De façon spectaculaire, la question du péché est balayée d’un simple revers de main, comme absolument non pertinente pour les Juifs (Yom Kippour n’étant, faut-il conclure, qu’un sympathique festival annuel) : seule la libération sociale et surtout politique semble avoir un sens. Sans doute cela n’apparaît-il pour l’auteur que comme un ajout secondaire, plus faible, destiné à remplacer par défaut l’échec de l’entreprise politique. Il oublie ainsi le reproche grave adressé à Jésus, à Capharnaüm, de prétendre pouvoir pardonner les péchés (prétention très lourde de conséquence, puisque c’est une prérogative divine). Jésus répond alors en guérissant le malade, comme signe de cette plus grande puissance de miséricorde, soit l’inverse d’un chef de guerre cherchant à renverser des structures politiques mais se souciant peu du péché. De même, l’autorité reconnue à Jésus, considéré par principe comme un paysan analphabète, ne peut selon l’auteur qu’être un discours violent d’opposition au Temple, et non la marque d’une compréhension plus profonde des Écritures, et donc d’une assurance que des savants desséchés ne peuvent avoir. Enfin, la question des esprits chassés est rabattue uniquement sur une vocation de guérisseur commune à d’autres personnages du temps, les affirmations de ces esprits sur l’identité de Jésus étant de même balayées comme des ajouts tardifs de peu de signification.

Il est bien question de l’identité du Messie, mais uniquement comme une relecture rétrospective introduite indûment dans les Évangiles. La référence aux Écritures juives faite par l’auteur vise uniquement à rappeler qu’elles ne suffisent pas à dessiner un portrait très précis du Christ attendu (ce qui est vrai), mais cela conduit à l’idée que le Messie qu’est Jésus est une réinterprétation excessive ou forcée des textes. Ainsi, aux yeux de Reza Aslan, les Écritures sont une simple suite de manifestes politiques, malheureusement pas très clairs, sur le Libérateur d’Israël, sans cohérence ni unité. La fermeture totale au sens des Écritures de l’auteur éclate par exemple dans l’évocation d’Ac 2, 30-31, où Pierre cite Ps 16, 9-11 : « Simon Pierre, affichant la confiance inébranlable de l’ignorant et du non-initié aux textes sacrés, allait jusqu’à arguer que le roi David en personne avait prophétisé le crucifiement et la résurrection de Jésus dans l’un de ses Psaumes. » Le seul argument de notre exégète de fortune est que Pierre aurait dû savoir, comme n’importe quel habitant de Jérusalem (mais il n’est qu’un provincial intellectuellement limité), que David chantait ce psaume « pour sa gloire personnelle ». L’argument laisse pantois, d’autant qu’il s’agit bien moins de gloire que d’espérance dans ce psaume. Le fait qu’un texte scripturaire se charge d’un sens nouveau lorsqu’il est relu dans un contexte nouveau, base de l’interprétation des Écritures chez les juifs puis chez les chrétiens, lui est inintelligible.
Un peu plus loin, Reza Aslan rejette en bloc toute relecture des Écritures dans le sens de l’annonce d’un Messie crucifié : « dans toute l’histoire de la pensée juive, il n’existe pas une seule ligne de texte sacré posant que le messie doit souffrir, mourir et ressusciter le troisième jour, ce qui explique peut-être que Jésus ne se soucie pas de citer les Écritures pour étayer son affirmation stupéfiante. » On se demande franchement ce qui est le plus stupéfiant. Des siècles de patristique, deux mille ans d’exégèse chrétienne, et même des travaux comme ceux de René Girard, sont réduits à de simples fantasmes sans le moindre commencement de fondement [3]. Et ce, sans la moindre argumentation, si ce n’est une fois encore que les disciples étaient de toute façon trop stupides et illettrés pour pouvoir développer une réflexion scripturaire (pour autant qu’une réflexion scripturaire ait un sens pour Reza Aslan, selon qui les Écritures doivent présenter un programme clair et explicite, être quelque chose comme un tract électoral qui engagerait son auteur). Curieusement, une tradition ancienne rapporte que deux membres du Sanhédrin, tous deux versés dans les Écritures, Gamaliel et Nicodème, sont devenus chrétiens : avaient-ils cessé de penser ou oublié leurs textes ? Reza Aslan n’en affirme pas moins que seuls les juifs de la Diaspora se sont montrés réceptifs à l’annonce des disciples de Jésus.
En fait, de façon paradoxale, pour ne pas dire délirante, « le lancement d’une religion entièrement nouvelle, radicalement et irréconciliablement scindée de tout ce que sa propre confession a jamais postulé sur la nature de Dieu et de l’homme, et sur la relation de l’un à l’autre », trouve sa source au bout du compte en… Étienne, premier martyr. C’est lui qui achève de faire disparaître le paysan analphabète de Galilée derrière le Messie lui qui, le premier, aurait parlé de Jésus comme Dieu. Il est patent dans les procédés d’écriture que le récit de la mort de Jésus et celui du martyr d’Étienne sont parallèles, mais Reza Aslan semble curieusement faire du second un récit authentique (en tout cas décisif), quand le premier serait totalement reconstruit (du reste seulement quelques décennies plus tard). Pourquoi faire plus confiance aux Actes qu’aux Évangiles, et faire d’Étienne le modèle du Messie Jésus, plutôt que l’inverse, puisque les Actes sont globalement cohérents avec la représentation de Jésus par les Évangiles ? La question reste ouverte…

Il n’en reste pas moins que les apôtres « étaient gravement handicapés par leur incapacité à exposer le fondement théologique de leur nouvelle confession ou à composer des récits instructifs sur la vie et la mort de Jésus » : il leur a fallu Étienne, Paul, les évangélistes, c’est-à-dire des disciples qui n’ont pas marché avec Jésus et ne l’ont jamais connu directement. Ces gens hellénisés et cultivés auraient d’autant plus facilement fait de Jésus « un être céleste entièrement indifférent aux préoccupations terrestres » – contre toute lecture un peu sérieuse des Évangiles, et contre tout ancrage juif et scripturaire que les exégètes chrétiens ont pourtant passé deux mille ans à déployer. Que ce christianisme naissant présenté par Reza Aslan ressemble plus à la gnose violemment combattue très tôt dans l’histoire de l’Église ne semble poser aucun problème. Il s’agit d’un vieux cliché, réapparaissant régulièrement sous diverses formes, qui fait du christianisme une religion hellénisée, un mysticisme intellectuel, affranchi de la poussière de Judée. Dans la même veine, Reza Aslan affirme de façon hallucinante, pour illustrer ce que la disparition du culte rendu au Temple aurait provoqué : « le christianisme, après la destruction de Jérusalem, était une religion presque exclusivement païenne ; il lui fallait une théologie païenne aussi. »
Concernant la résurrection, Reza Aslan est contraint d’admettre que « ce fut précisément la ferveur avec laquelle ses partisans crurent en sa résurrection qui fit de cette infime secte juive la première religion au monde ». Il n’en cherche pas moins à expliquer de façon confuse que cette revendication remonte aux origines de la communauté chrétienne et en même temps que les récits de résurrection sont très tardifs et sont censés avoir été écrits pour répondre aux objections formulées pendant 60 ans (Jésus mange : il n’est donc pas un spectre, etc.) – comme s’il avait fallu tout ce temps à la communauté chrétienne pour être enfin capable d’écrire un récit sur ce qui constitue pourtant le cœur de la foi, en trouvant enfin quoi répondre à des objections tout à fait basiques. Sur quelle base les premiers disciples auraient-ils donc adhéré à la communauté, à part une forme d’enthousiasme irrationnel de la part de Pierre et des autres ?
À ce sujet, Reza Aslan nous ressort les poncifs éculés sur le rôle de Paul, qui supplanterait tous les apôtres et qui serait le vrai personnage central des Actes, écrits par le « vil flatteur » qu’était Luc (belle objectivité historique !). Tout ne serait encore que posture, reconstruction, mensonges pour justifier des positions, des statuts : un monde de médiocres se disputant pour un peu de pouvoir et reconstruisant l’histoire à leur avantage. Qu’il y ait eu des tensions, des disputes, des réflexions de fond sur les orientations de la nouvelle communauté, comme il y en a encore aujourd’hui dans l’Église, c’est une certitude, et le rôle de Paul est à l’évidence considérable. Mais cela n’autorise pas à caricaturer de façon grossière les positions. La présentation de la théologie paulinienne, circonscrite en deux ou trois phrases [4], est d’un simplisme insultant. Paul serait en train de rompre tous les ponts, d’imposer sa vision personnelle, détachée du Jésus historique qu’il n’a pas connu : pourtant, le fait même que l’on continue dans l’Église de lire les Actes et les lettres de Paul autant que les Évangiles ou les autres lettres, que l’on évoque autant les actes les plus concrets de Jésus que sa divinité, et même qu’on les associe profondément, devrait inciter au minimum à une certaine prudence.

Las, l’argumentation une fois encore ne vaut que par son caractère péremptoire, opposant radicalement et définitivement Pierre et Paul, et mettant Jacques encore à part : il est évoqué surtout pour montrer que son effacement relève d’une inflexion majeure de l’Église romaine pour faire disparaître un premier christianisme messianique, plus proche du Jésus historique postulé par Reza Aslan, à savoir un libérateur des pauvres et un pourfendeur des riches. La méthode est de creuser au maximum toute faille réelle (il y en a) ou supposée (elles sont légion) pour créer un tableau le plus conflictuel possible, en ne choisissant que les textes ou les interprétations qui vont en ce sens. C’est au mieux extrêmement partial ; au pire, borné ou malhonnête. C’est ainsi que le Roman pseudo-clémentin (compilé au IIIe s., mais dont les textes sont effectivement plus anciens) est exhumé et érigé en document historique fondamental, parce qu’il va, au prix d’une certaine liberté d’interprétation, dans le sens exact de ce que Reza Aslan entend prouver.
Pour conclure, ce qui transparaît de cet ouvrage, c’est une lecture qui se résume en fait très bien aux mauvais présupposés de départ : Jésus n’est vu que par le prisme de la puissance romaine qui se serait sentie contestée voire menacée et l’aurait exécuté pour cette raison. Son identité se limiterait donc à ce que ses opposants romains et saducéens ont compris de lui, c’est-à-dire une simple menace contre leur pouvoir, sans jamais s’interroger au cours de leur jugement hâtif sur son origine, ses motivations ou sa pertinence. C’est une lecture impérialiste, limitée à un jeu de pouvoir, c’est-à-dire une lecture plus fermée encore que celle du Pilate des Évangiles que Jésus fait tout de même douter un temps, même s’il finit par en profiter pour amener les Juifs à déclarer leur soumission à Rome et faire passer un message à tout « roi des Juifs » potentiel. Reza Aslan rappelle au demeurant que dans les premières pages que, lors de sa conversion à 15 ans, Jésus « était l’Amérique », dans toute sa force : tout se passe comme s’il ne pouvait pas voir Jésus en dehors d’un conflit de puissance, comme si ce Jésus zélote, pourtant en échec total, était vraiment « aussi charismatique, aussi admirable que Jésus Christ ». Certes, il ne revient pas sur la façon dont le christianisme aurait miné et renversé l’empire romain pour devenir la religion que nous connaissons aujourd’hui, mais la focalisation sur une problématique de renversement de la puissance romaine entre bien dans cette même perspective laborieusement rabâchée par des exégètes récents.
Il est singulier de voir comment cette même vision resurgit dans le récent film sur la Résurrection du Christ (Risen), où l’enjeu de la chasse au corps du crucifié est au départ d’éviter de miner la puissance romaine à l’heure où précisément l’Empereur lui-même est en visite en Judée. L’ajout de ce détail sans aucun fondement historique a pour seul effet d’opposer directement Jésus et le pouvoir romain, en forçant à l’excès une opposition qui n’est que très secondairement pertinente.
Reza Aslan n’a manifestement jamais eu le temps d’approfondir le sens de la conversion qu’il a vécue à 15 ans et il se retrouve aujourd’hui aussi étranger à la lecture des Écritures qu’il l’était auparavant. Ce choc émotionnel n’a pas été réfléchi et enraciné, ce qui limite singulièrement sa capacité à affirmer connaître et comprendre la foi chrétienne. Il ne lui reste qu’à invalider la quasi-totalité des Évangiles pour prétendre en tirer une leçon plus véritable – scientifiquement, c’est une démarche plus qu’étrange, quand bien même il ne serait pas le premier à procéder de la sorte.
Un dernier élément laisse songeur. Reza Aslan regrette manifestement la disparition de la communauté de Jérusalem, autour de Jacques, qu’il considère comme le vrai et pur porteur du message de son Jésus messianique et libérateur, et à laquelle il consacre ses dernières pages. À l’heure où de nombreuses thèses voient l’origine de l’islam dans l’hérésie judéo-chrétienne, issue notamment de cette communauté juive qui accueille la messianité de Jésus sans trouver sa place dans l’Église telle qu’elle s’est développée, la coïncidence est troublante. Reza Aslan semble confirmer pour sa part cette continuité, en s’appuyant certes sur des lectures nombreuses d’historiens, qu’il ne garde toutefois que dans le sens qui lui convient, et sans aucune sensibilité à l’exégèse juive et chrétienne des Écritures.
Cette idée d’une relecture des Évangiles selon une sensibilité musulmane a du reste également été suggérée par Olivier-Thomas Vénard qui, devant la réaffirmation constante que les disciples avaient réinventé Jésus, s’interroge en ces termes : « On finit par se demander ce que son travail « scientifique » doit à la thèse islamique de la falsification des écritures par les autres croyants (tahrîf). »
Mais alors, que n’a-t-il pas compris, finalement ? Que signifie donc interpréter les Écritures en général et les Évangiles en particulier d’une façon ajustée et féconde ? C’est ce que nous verrons dans notre deuxième article.
[1] Pour une introduction, lire Une exégèse d’oralité (Cariscript, 2012). Voir aussi son livre La récitation orale de la Nouvelle Alliance selon saint Matthieu (Cariscript 2014) qui montre de façon très détaillée comment l’Évangile s’est constitué de façon très structurée, pour l’essentiel, sur le modèle d’une transmission orale. Le site www.eecho.fr reprend l’actualité de cette approche.
[2] Pour des lectures critiques, voir par exemple http://www.revue-resurrection.org/Compte-rendu-critique-de-l-ouvrage et http://www.revue-resurrection.org/De-l-annonce-du-Royaume-a-l.
[3] Lire que le Livre de la Sagesse et le Siracide « s’apparentent plus à des traités de philosophie grecs qu’à des textes sacrés sémitiques » (p. 290) laisse franchement pantois. L’auteur est manifestement totalement hermétique à une lecture un peu sérieuse des Écritures.
[4] Citons seulement la supposée contradiction entre Rm 10,13 (« quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ») et Mt 7,21 (« ce n’est pas en me disant “Seigneur, Seigneur” qu’on entrera dans le Royaume des Cieux »). Reza Aslan veut-il vraiment nous faire croire qu’il ne voit pas que le texte de l’Évangile critique non pas le titre de Seigneur ou le fait de l’invoquer, mais la prière qui se contente de rabâcher de façon creuse ?